Engagement 3
Rattraper le retard en matière de scolarisation
Publié le |

L’accès à l’école ordinaire permet non seulement l’accès aux apprentissages, mais aussi la socialisation et l’inclusion dans la société, pour le présent et le futur. Les actions prévues dans le cadre de cette stratégie visent à créer une école plus inclusive. L’ambition est de généraliser l’accès des enfants autistes à l’école, de personnaliser leurs parcours et d’en garantir la continuité jusqu’à l’insertion sociale et professionnelle. La formation de tous les professionnels de l’éducation intervenant sur les parcours des enfants et adolescents est une condition essentielle.
Création de nouvelles places en milieu ordinaire en école maternelle, élémentaire et au collège
L’une des priorités de la stratégie est de scolariser tous les enfants autistes-TND, à plein temps et dans les écoles ordinaires autant que possible.
Pour tout savoir sur la rentrée, consultez l'article dédié en cliquant ici.
Objet, contexte, objectif :
La stratégie vise à ouvrir divers types de classes et de dispositifs pour les élèves avec un TSA de façon à répondre au mieux à la diversité de leurs besoins.
Mise en œuvre :
Une attention particulière est portée à l’ouverture d‘unités d’enseignement en maternelle autisme (UEMA).
Ces classes accueillent 7 enfants de 3 à 6 ans dont les besoins demandent un accompagnement médico-social important tout au long de la journée de classe. Les professionnels médico-sociaux interviennent dans l’école, pendant le temps scolaire..
En 2023, 110 nouvelles classes ou nouveaux dispositifs spécifiques : 37 en maternelle, 73 en élémentaire, collège et lycée, dont 29 sont de nouveaux dispositifs appelés « d’autorégulation ». Une étude de cohorte pour observer les parcours de ces enfants scolarisés à partir de l’UEMA est lancée par le ministère de l’Éducation nationale. Ces unités d’enseignement sont aussi créées sur un modèle de fonctionnement analogue à l’école élémentaire (UEEA).
Au total, 410 classes créées en 5 ans. Plus de 1 000 nouveaux élèves autistes feront la rentrée au côté de leurs camarades pour une scolarité à plein temps en 2023.
Bilan : 535 classes sur l’ensemble du territoire à la rentrée 2023.
Les élèves présentant un TSA ou un autre TND sont également scolarisés à l’école ou au collège en bénéficiant d’unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) : ces unités proposent des temps de regroupement alternant avec des temps d’inclusion en classe ordinaire, le tout avec l’encadrement d’un enseignant spécialisé et d’un AESH dédié au dispositif.
Le chiffre clé : plus de 45 000 enfants concernés par un TND ont fait leur rentrée 2023 en milieu ordinaire
«Il était un peu rejeté́ du système, en tout cas, le système n’était pas adapté à lui... Et là, on se trouve dans un système qui veut fonctionner avec lui, en l’incluant pleinement…» - Témoignage d'un parent « Mon fils est en UEEA et pour lui ça a été un vrai changement. Il évolue, il grandit, apprend avec plaisir et devient un élève. Il est passé de résultats scolaires catastrophiques à de de très bons résultats scolaires. Même au niveau du comportement, les crises ont fortement diminué : on passe de plusieurs crises par jour à une tous les deux ou trois mois parfois. C’est génial ! »- Témoignage d’une mère
Déploiement de dispositifs d’autorégulation dans les premier et second degrés
En France, à la rentrée 2023, 29 nouveaux dispositifs ont vu le jour dans les écoles élémentaires et s’ajoutent aux dispositifs déjà existants sur le territoire. Le dispositif d’autorégulation est une innovation importée du Canada.
Objet, contexte, objectif :
Les enfants sont présents dans la classe ordinaire correspondant à leur niveau et bénéficient en plus d’un programme individualisé par une équipe formée à l’autorégulation. Un local de l’école est dédié aux activités d’autorégulation qui peuvent être proposées individuellement ou en petits groupes. L’enseignant et l’équipe d’autorégulation leur apprennent à mieux contrôler leur attention, leurs comportements et leurs émotions tout au long de la journée scolaire.
Cet entraînement permet à chaque élève concerné, lorsqu’il se sent prêt, de rejoindre sa classe et d’y suivre les enseignements dispensés. Tout le personnel de l’école est formé aux principes de l’autorégulation. Ainsi, toute l’école est amenée à engager des changements de pédagogie et d’organisation qui profitent à tous les élèves (y compris à la cantine et à la récréation).
Mise en œuvre : 9 dispositifs d’autorégulation ont vu le jour dans les écoles élémentaires à la rentrée 2020, 17 en 2021, 15 en 2022 et 29 en 2023.
Le chiffre clé : environ 70 dispositifs innovants d’autorégulation ont été créés. Les enfants sont majoritairement présents dans la classe ordinaire correspondant à leur niveau et bénéficient, en plus, d’un programme individualisé d’autorégulation par une équipe spécialisée qui les entrainent à mieux contrôler leur attention, leurs comportements et leurs émotions tout au long de la journée scolaire. Cet entraînement permet à chaque élève concerné, lorsqu’il se sent prêt, de rejoindre sa classe et d’y suivre les enseignements dispensés. Tout le personnel de l’école est formé aux principes de l’autorégulation.
«Je constate une réelle émulation autour d’un travail collaboratif entre l’équipe médico-sociale et pédagogique. Le handicap n’est plus un frein, au contraire, il devient facilitateur de progrès.» - Témoignage d’une principale adjointe d'un collège
Recrutement, formation et déploiement des professeurs-ressources pour les TSA et TND
Dans chaque département est créé un poste de professeur-ressources sur les troubles du spectre de l’autisme pour aider à la bonne scolarisation des élèves du premier et du second degré.
Objet, contexte, objectif :
Le professeur-ressources intervient dans les établissements scolaires, auprès des équipes pédagogiques et des enseignants qui accueillent dans leurs classes des enfants autistes, pour les aider à mieux comprendre les besoins des élèves concernés, les conseiller, leur indiquer des outils et leur proposer des adaptations de leurs pratiques d’enseignement.
Mise en œuvre : La stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022 avait prévu l’installation de 100 professeur-ressources.
En 2019, 51 enseignants spécialisés ont été nommés et formés, puis 49 en 2020. Pour la rentrée de septembre 2023, il été décidé de créer 25 postes de professeurs ressources supplémentaires. Ces professeurs pourront intervenir dans un établissement qui accueille des élèves autistes ou avec un autre TND (Dys TDAH, TDI). Ces professeurs-ressources ont reçu 200 heures de formation en alternance durant leur première année d’exercice, à l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA).
Le chiffre clé : 126 professeurs-ressources sur le TSA et les TND en 2023
«L’accompagnement des collègues, au plus près de leurs réalités dans les classes, permet de voir que de nombreux enseignants sont en route, cherchent et se démènent, pour scolariser les enfants autistes.» - Témoignage d’un professeur-ressources
Accompagnement des élèves présentant un TND en lycée professionnel
Les élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme ou un autre trouble du neuro-développement doivent avoir accès à tous les parcours scolaires proposés dans les collèges et les lycées. Leur parcours doivent être personnalisés et sécurisés jusqu’à l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale.
Objet, contexte, objectif : Les élèves avec TSA et TND doivent donc pouvoir suivre une formation générale ou professionnelle, que ce soit en milieu ordinaire, dans les collèges, au sein d’unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) ou de sections d’enseignement général adapté (Segpa), dans les lycées d’enseignement général et technologique, dans les lycées professionnels (notamment avec l’appui d’une Ulis). Ils peuvent également être accompagnés dans une formation par l’apprentissage ou en alternance ou encore dans un établissement de l’enseignement agricole.
Mise en œuvre : Pour faciliter la continuité des parcours scolaires au-delà de la classe de 3e, la stratégie nationale 2018 - 2022 pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement avait prévu la création de 30 Ulis d’ici à 2022 en lycée professionnel et la scolarisation de 500 adolescents supplémentaires.
A la rentrée 2023, 850 Lycéens autistes pourront faire leur rentrée dans une des 29 ULIS TSA en lycée général ou technologique, et dans l’une des 42 ULIS en lycée professionnel
La Délégation interministérielle avait donc réorienté 11 millions d’euros de crédits médico-sociaux pour financer des dispositifs de type Sessad, pôles de compétences et de prestations externalisées, services expérimentaux prioritairement dédiés à l’accompagnement des adolescents autistes engagés dans une formation professionnelle ou technologique.
Renforcement de l’accès à l’enseignement supérieur
L'accès des personnes autistes aux études supérieures est déterminant pour la poursuite de leur parcours d'inclusion scolaire et leur accès à l'emploi.
Objet, contexte, objectif : La stratégie nationale prévoit de faciliter l’orientation et l’accès aux études supérieures aux étudiants qui ont un TSA ou un TND. C’est le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation qui est mobilisé sur cet objectif. Les effectifs des étudiants concernés par un trouble du spectre de l’autisme ou un TND croissent de 38 % par an en moyenne depuis 2016. En 2019, 1 114 étudiants avec TSA étaient accompagnés par les dispositifs handicap des établissements supérieurs.
Mise en œuvre :
Tout d’abord, la plateforme Parcoursup permet de renforcer l’accessibilité à l’enseignement supérieur. En particulier, les candidats présentant un trouble du spectre de l’autisme ou du neuro-développement peuvent être accompagnés individuellement jusqu’à la fin de la procédure par les commissions académiques d’accès à l’enseignement supérieur et bénéficier d’un traitement spécifique de leur dossier, non limité à la procédure d’algorithme standard.
Entre la rentrée 2018 et la rentrée 2019 (année de mise en place de Parcoursup), le taux d’entrée en première année d’enseignement supérieur des candidats avec TSA a progressé de près de 20 points (+ 27 % à la rentrée 2018, + 35 % à la rentrée 2019).
Des actions sont également menées pour améliorer la qualité de l’accompagnement des étudiants.
En 2019, 94 % des étudiants autistes avaient un plan d’accompagnement défini pour leurs études et mis en place par le référent handicap de l’établissement.
Un guide d’aide à l’évaluation des besoins des étudiants avec TSA et un vademecum des pratiques des établissements a été publié par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. De plus, la Stratégie nationale soutient le programme Atypie Friendly.
Il s’agit d’un réseau de référents dédiés à l'accueil et à l'accompagnement des étudiants ou futurs étudiants autistes. Plus de 300 étudiants sont désormais accompagnés dans une vingtaine d’universités. Des actions de formation spécifiques sont proposées aux enseignants du supérieur.
Les chiffres clés :
- 94 % des étudiants autistes ont un plan d’accompagnement pour leurs études
-
26 établissements universitaires adhérents au programme « Atypie-friendly », financé dans le cadre des PIA (Projets d’investissement d’avenir) pour une durée de dix ans : il vise à faciliter l’inclusion à l’université des futurs et actuels étudiants autistes et propose des formations et des ressources spécifiques pour les enseignants. Des actions de sensibilisation ont été également organisées à l’initiative de la Conférence des Grandes écoles (CGE).
-
100% de continuité entre les adaptations pédagogiques en classe et les aménagements des examens. La procédure pour l’aménagement des examens a été simplifiée et un formulaire nationale unique a été mis en place. Les aménagements obtenus une fois sont automatiquement reconduits sans nouvelles démarches (par exemple entre le brevet des collèges et le bac) si la situation de l’élève n’a pas changé. Le décret du 12 novembre 2021 rend en outre possible la portabilité pour les examens et concours de l’enseignement supérieur (par exemple grandes écoles) des aménagements obtenus au cours de la scolarité secondaire (collège et lycée).
-
3700 enseignants du supérieur et personnels administratifs de l’université et professionnels des services des Crous relatifs à l’hébergement, la restauration et aux transports ont été formés ou sensibilisés aux TSA.
“Merci encore au programme Aspie Friendly sans lequel je n'aurais pas eu le courage de reprendre les études.” - Un étudiant à l'Université Clermont-Auvergne
Et aussi
-
Engagement 1
Remettre la science au cœur de la politique publique de l'autisme
Date de mise à jour le
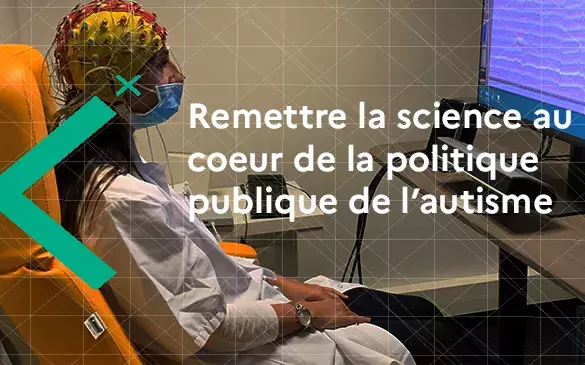
-
Engagement 2
Intervenir précocement auprès des enfants présentant des écarts inhabituels de développement
Date de mise à jour le
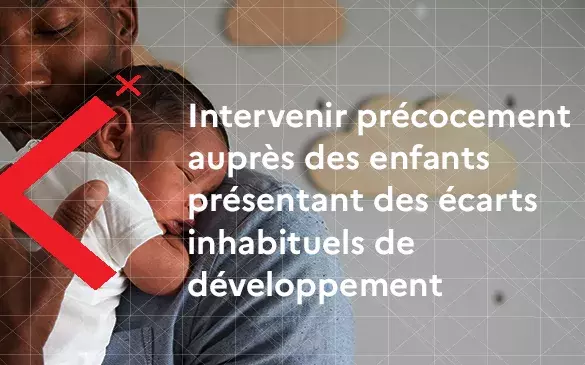
-
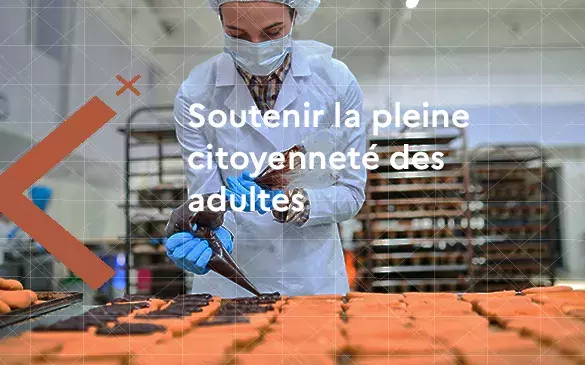
-

-
La formation
Afin de garantir la mise à jour actualisée de la formation des professionnels du travail social
Autisme et TND | Date de mise à jour le

-
La qualité
La Haute Autorité de santé, a publié des recommandations de bonnes pratiques professionnelles concernant les TND.
Autisme et TND | Date de mise à jour le
