École inclusive
Publié le Mis à jour le 13/01/2026 |
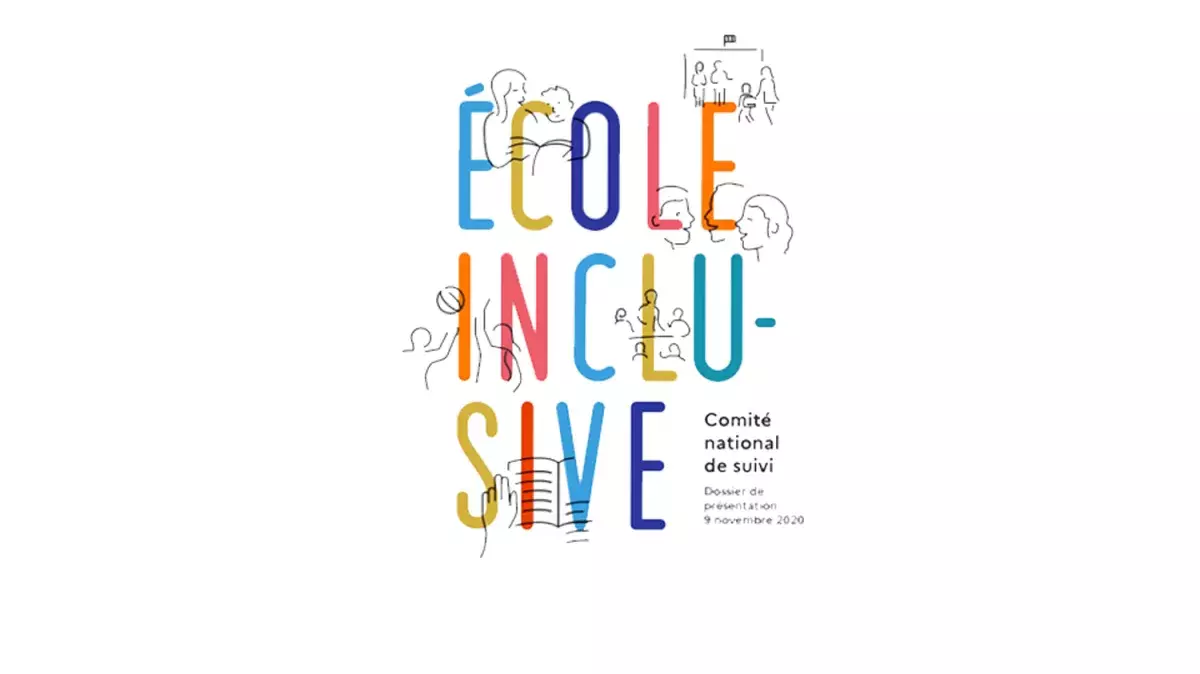
La scolarisation des enfants handicapés est une priorité du Gouvernement.
Elle s'articule autour de trois objectifs : adapter les parcours scolaires et professionnels, avec des aménagements spécifiques, former les enseignants.
L’accès à l’éducation pour les élèves en situation de handicap a connu une nette amélioration depuis la loi de 2005. Aujourd’hui, près de 520 000 élèves en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire, contre environ 130 000 en 2005.
Le nombre d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) dépassait 3 000 à la rentrée 2024. Ce progrès est le résultat d’un engagement fort pour développer une école plus inclusive et accessible à tous.
L’École pour tous, une ambition politique renouvelée
Tous les enfants sont en capacité d’apprendre, dès lors qu’ils disposent de conditions adaptées pour assurer leurs progrès. L’École pour tous vise à garantir à tous les élèves la possibilité de bénéficier des parcours scolaires fructueux. L’ensemble des besoins des élèves, même les plus spécifiques, doivent être pris en compte dans l’enseignement. Des professionnels du secteur médico-social ou des accompagnants peuvent soutenir les enseignants dans cette démarche.
La Conférence nationale du handicap (CNH) de 2023 a renforcé les engagements pour les trois prochaines années avec comme priorité l’amélioration de la qualité des conditions de scolarisation des élèves en situation de handicap, la formation des professionnels, l’accueil et l’écoute des familles, l’articulation entre l’école et le médico-social. Les mesures de la CNH sont confortées et complétées par les Comités interministériels du handicap (CIH) chaque année.
De nombreuses mesures ont déjà été mises en place pour améliorer la scolarisation des enfants en situation de handicap, notamment :
- un programme national de formation des personnels de l’Éducation nationale ;
- le déploiement d’équipes mobiles d’appui médico-social à la scolarisation (EMAS) sur tous les départements depuis 2019 ;
- l’intervention de nouveaux dispositifs intégrés médico-sociaux directement au sein des établissements scolaires (dispositif institut thérapeutique éducatif et pédagogique – DITEP, dispositif d'accompagnement médico éducatif – DAME, dispositif intégré médico éducatif – DIME) ;
- la création d'un statut renforcé pour les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), à travers une nouvelle indemnité et l'amélioration de leur formation ;
- la mise en place de pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial) puis des pôles d’appui à la scolarité (PAS) afin de mieux coordonner les aides humaines, éducatives et thérapeutiques au plus près des besoins des élèves ;
- le lancement du Plan mercredi, pour garantir à tous les enfants, handicapés ou non, un accueil de loisirs éducatifs le mercredi ;
- un meilleur aménagement des épreuves des examens et des concours pour les candidats en situation de handicap.
Certaines mesures sont en cours de mise en place :
- l’attribution d’un identifiant national élève (INE) à tous les enfants, notamment ceux scolarisés dans les établissements médico-sociaux. Les élèves seront ainsi comptabilisés dans les effectifs de l’Éducation nationale, pour faciliter notamment l’accès aux bourses, au Pass Culture et aux inscriptions aux examens ;
- un plan métier pour les AESH s’ajoute à la possibilité de passer en CDI après trois ans ;
- l’expérimentation de nouvelles conditions de coopération avec les plateaux de services médico-sociaux ;
- le renforcement de la formation des professionnels pour les outiller sur l’approche neurosensorielle et les outils dédiés aux élèves à besoins éducatifs particuliers.
Les dispositifs pour assurer la scolarité de tous les enfants
Les projets d’appui à la scolarité
L’équipe éducative a pour rôle d’identifier les capacités de l’élève et ses besoins spécifiques. Selon les besoins de l’enfant, elle définit un projet pédagogique. Il existe différents projets d’appui à la scolarisation :
- Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) : lorsque l’élève présente des difficultés importantes, un plan d’actions individualisées est défini par l’équipe éducative pour une durée déterminée. Cet accompagnement pédagogique spécifique peut faire intervenir des professionnels extérieurs (enseignants, psychologues, orthophonistes, etc.).
- Le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) : ce dispositif d’accompagnement prévoit des aménagements et adaptations pédagogiques pour des élèves dont les difficultés découlent de troubles de l’apprentissage (prise en charge extérieure durant les heures scolaires, aménagements des examens, mesures de mise en accessibilité des apprentissages…). Le PAP est réactualisé et enrichi tous les ans.
- Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) : cet outil est le principal moyen de pilotage du parcours de scolarisation. Il s’adresse aux élèves reconnus en situation de handicap qui nécessitent des aménagements ou une compensation sur le plan scolaire. Il est décidé par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et rédigé par la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH). Le PPS définit les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers de l’élève.
- L’enseignant référent est l’interlocuteur privilégié des acteurs du projet. Il s’assure de la mise en œuvre du PSS avec l’aide de l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) et maintient le lien avec la famille et avec l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Le PPS est évalué chaque année.
Pour aider les professionnels dans la mise en œuvre des PPL, PPRE et PAP, une application numérique recense les réponses pédagogiques aux besoins spécifiques des élèves : le livret de parcours inclusif (LPI).
Les parcours de scolarisation
La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) décide de l’orientation scolaire de l’enfant, avec l’accord de la famille. Plusieurs dispositifs d’appui ou établissements spécialisés peuvent accueillir l’élève en fonction de ses besoins.
Option privilégiée si la nature des besoins de l’élève le permet, l’enfant en situation de handicap peut suivre une scolarité en classe ordinaire avec des enfants de son âge. Il pourra bénéficier, selon ses besoins :
- d’aménagements pédagogiques ;
- de matériels adaptés ;
- d’un accompagnement humain (accompagnants des élèves en situation de handicap – AESH).
Dans certains cas, l’élève peut bénéficier d’un soutien pédagogique particulier au sein d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) au collège ou au lycée. L’élève suit les cours au sein de sa classe de référence et peut se retrouver au sein d’un petit groupe avec des besoins partagé dans une classe réservée à cet usage. C’est un appui à la scolarité ordinaire.
En 2024, 5 477 dispositifs ULIS sont déployés dans le premier degré et 5 569 dispositifs dans le second degré.
La scolarité dans une classe dédiée est une autre solution, notamment pour les enfants autistes, selon leur âge. Cette classe spécifique peut-être une unité d’enseignement maternelle autisme (UEMA), ou une unité d’enseignement élémentaire autisme (UEEA).
Grâce à ce dispositif, les élèves bénéficient à la fois d’un environnement en milieu ordinaire et d’enseignements adaptés à leurs besoins spécifiques. L’équipe se compose généralement d’un enseignant spécialisé, éducateurs, psychologues, psychomotriciens et orthophonistes.
Les élèves autistes peuvent également bénéficier de dispositifs d’autorégulation en milieu ordinaire soit la présence permanente dans l’école d’un enseignant dédié, d’éducateurs spécialisés, d’un psychologue.
L’orientation vers un établissement médico-social propose à l’élève en situation de handicap une prise en charge scolaire, éducative et thérapeutique adaptée. Différents établissements offre un dispositif de scolarisation adapté :
- Les instituts médico-éducatifs (IME) intègrent des jeunes pour qui le rythme d’apprentissage d’une classe en milieu ordinaire, bien que prioritaire, ne peut répondre de manière suffisante à leurs besoins spécifiques. Les IME sont accessibles à des élèves de 3 à 20 ans présentant une déficience à prédominance intellectuelle.
- Les instituts d’éducation motrice (IEM) accueillent des jeunes dont le handicap physique est trop important pour permettre leur autonomie. Ils déploient des moyens spécifiques dans le suivi médical, l’éducation spécialisée et la formation.
- Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) prennent en charge des jeunes dont les troubles psychologiques entravent gravement leur socialisation et leur accès aux apprentissages.
- Les instituts d’éducation sensorielle (IES) accueillent des enfants et adolescents de 3 à 18 ans avec un handicap visuel ou auditif. Ces jeunes nécessitent des soins adaptés, ainsi qu’un suivi médical de leur état sensoriel pour prévenir les conséquences sur leur développement.
- Les établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés (EPEAP) sont dédiés aux jeunes présentant un polyhandicap. L’association de déficiences motrices et mentales, troubles du comportement, troubles autistiques, etc., entrave leur autonomie et nécessite une surveillance médicale et des soins spécifiques pour développer leurs capacités fonctionnelles.
- L’unité d'enseignement (UE) est un dispositif de scolarisation des établissements ou services médico-sociaux (ESMS) dédié aux jeunes qu’ils accueillent. Elle peut être localisée pour tout ou partie au sein des établissements médico-sociaux ou des établissements scolaires. Les enfants concernés peuvent également suivre certains cours en milieu ordinaire.
L’accompagnement des élèves en situation de handicap
L’accompagnement des élèves en situation de handicap peut être :
- matériel : adaptation des supports (textes aéré, agrandis, etc.), matériel informatique adapté (clavier braille ou logiciels spécifiques par exemple), etc. ;
- pédagogique : aménagements d’horaires ou d’un emploi du temps, dispense de certains cours, allègement du travail scolaire, adaptation des évaluations (majoration du temps imparti, dispense d’épreuve,...), etc.
- humaine : accompagnement d’une personne formée pour aider l’enfant en situation de handicap à gagner en autonomie. C’est la mission des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH).
Depuis la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 actant leur création, les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) constituent l’une des pierres angulaires d’un système scolaire plus inclusive.
Ils accompagnent les enfants en situation de handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans leurs apprentissages et dans leurs activités sociales. Ils peuvent s’occuper d’un ou plusieurs élèves en fonction des besoins.
Une meilleure reconnaissance de leur métier et de leur place au sein du corps enseignant œuvre en faveur de la qualité de l’accueil des enfants avec des besoins éducatifs spécifiques. Ainsi, le décret n° 2020-1287 du 23 octobre 2020 et l’arrêté du 23 octobre 2020 ont acté la création d’une nouvelle indemnisation à hauteur de 600 euros brut annuels pour les AESH référents. Elle vient conforter leur rôle essentiel d’appui et d’accompagnement des AESH auprès de leurs homologues.
Le décret du 13 juillet 2023 acte la possibilité aux AESH exerçant depuis trois ans en contrat à durée déterminée de signer un contrat à durée indéterminée en application de la loi n° 2022-1574 du 16 décembre 2022 visant à lutter contre la précarité de cette profession.
Par ailleurs, 3 000 AESH supplémentaires ont été recrutés à la rentrée 2024, soit un total de 140 000 AESH sur toute la France.
Depuis 2018, l’accompagnement humain au sein des établissements scolaires est géré par les pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL). Ils établissent les emplois du temps des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) au plus près des besoins des élèves.
Ce dispositif est remplacé progressivement par les pôles d’Appui à la Scolarité (PAS) à la suite des annonces de la Conférence nationale du handicap (CNH) d’avril 2023, pour une coordination des aides humaines, éducatives et thérapeutiques au plus près des élèves. Depuis le 1er septembre 2024, quatre départements préfigurateurs se sont engagés dans la mise en place de ce dispositif novateur au service de la réussite scolaire des élèves avec des besoins éducatifs particuliers : l’Aisne, la Côte-d'Or, l'Eure-et-Loir et le Var. Les territoires de la Collectivité européenne d’Alsace, la Meuse, le Vaucluse et la Réunion feront partie des prochains territoires sur lesquels les PAS sont déployés et seront suivis par d’autres départements pour la rentrée 2025.
Quelles sont les missions d’un PAS ?
Les pôles d’appui à la scolarité visent à accompagner les élèves qui rencontrent des difficultés dans leur scolarité grâce à des mesures d’adaptation pédagogiques et éducatives. Ce dispositif vient en appui de l’équipe enseignante, au sein des classes directement ou dans des lieux dédiés au sein des établissements.
Ils ont pour objectif de :
- faciliter l’inclusion scolaire de tous les élèves dans le système scolaire ordinaire, qu’ils soient en situation de handicap ou avec des besoins éducatifs particuliers, grâce à un appui pédagogique et éducatif ;
- accueillir et conseiller les familles ;
- soutenir les équipes pédagogiques afin d’assurer le déploiement de méthodes pédagogiques différenciées et l’adaptation des pratiques d’enseignement.
Une approche personnalisée et pluridisciplinaire
Les pôles d’appui à la scolarité s’appuient sur une approche collaborative et pluridisciplinaire portée par un binôme composé d’un enseignant et d’un éducateur spécialisé, appuyé par une équipe de professionnels qualifiés : éducateurs, psychologues, orthophonistes, etc. Ils assurent le soutien et le suivi des élèves selon plusieurs étapes :
- l’identification des besoins, en lien avec la famille, les enseignants et les professionnels de santé ;
- la mise en place d’un plan d’action qui réponde aux besoins évolutifs de l’élève ;
- le suivi et l’évaluation des progrès de l’élève grâce à des réunions avec les différents interlocuteurs impliqués.
Les solutions proposées sont d’ordre pédagogiques, éducatifs ou organisationnels. Les réponses pédagogiques correspondent à des aménagements éducatifs, la mise à disposition de matériels pédagogiques adaptés aux besoins de l’élève, le soutien de l’équipe enseignante et des professionnels du secteur médico-social.
D’un point de vue organisationnel, le pôle d’appui à la scolarité se charge de la mise en œuvre des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) et de la coordination des professionnels externes à l’établissement, notamment médicaux et paramédicaux. Leur mission se distinguent de celle des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) qui agissent pour la reconnaissance des situations de handicaps et les propositions de compensations.
Pour plus d’informations sur les pôles d’appui à la scolarité :
Les avancées réalisées dans la scolarisation des enfants en situation de handicap témoignent d’un engagement croissant en faveur de l’école inclusive.
Pour poursuivre cette progression, des leviers d’amélioration ont été identifiés : renforcer les accompagnants, réduire les disparités territoriales dans l’accès aux dispositifs d’inclusion et poursuivre la montée en compétence des enseignants dans l’accueil des élèves en situation de handicap.
Ces leviers constituent des sujets majeurs pour consolider une école toujours plus ouverte et équitable.